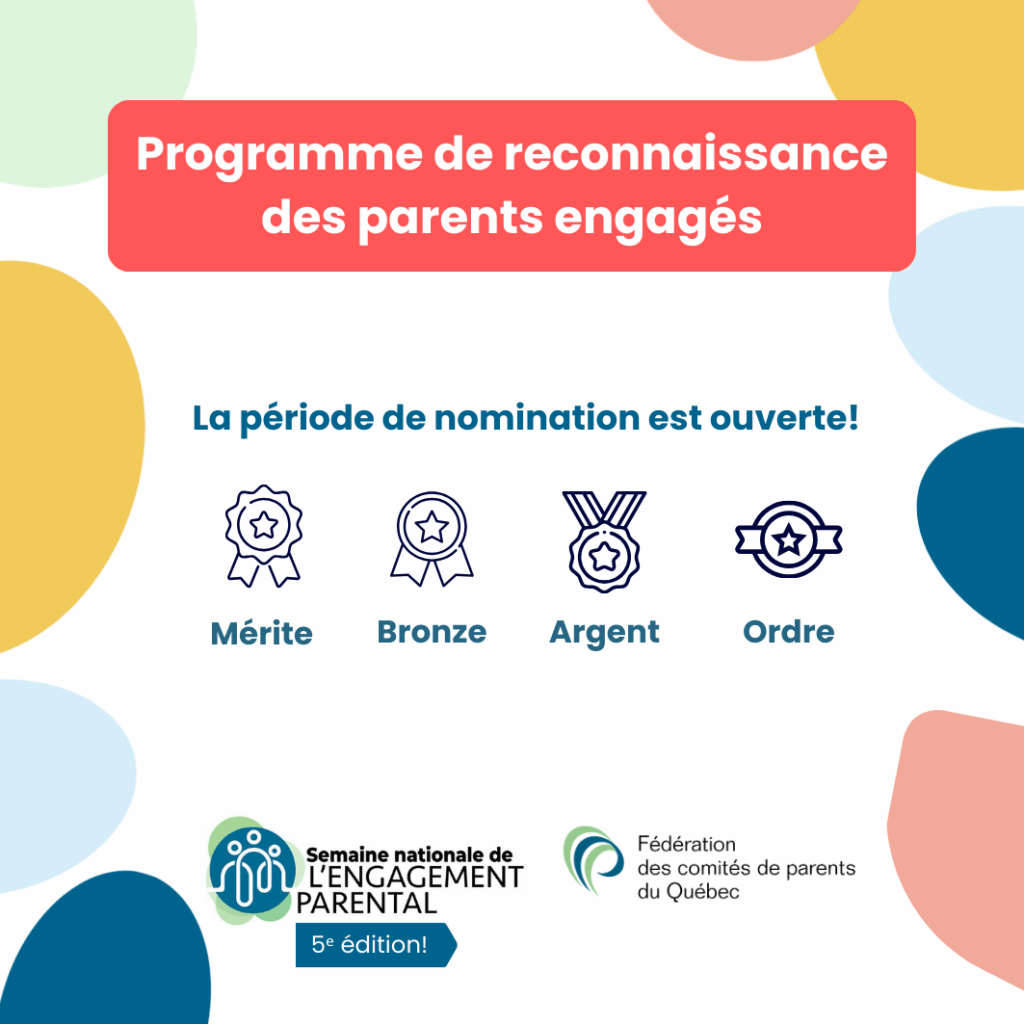Des élèves du secondaire moins à l’aise qu’avant avec les réalités LGBT+


Par l’équipe de GRIS Montréal
« Bon après-midi, tout le monde! Je m’appelle Adam, j’ai 35 ans. Je suis un homme bisexuel. Je suis en couple avec mon amoureux Jo depuis cinq ans et on a une petite fille d’un an qui s’appelle Louise… »
Les interventions en classe du GRIS-Montréal débutent toujours par un moment où les bénévoles se présentent en quelques mots, avant de répondre aux questions des élèves. Le GRIS-Montréal est un organisme dont la mission est de démystifier l’orientation sexuelle et l’identité de genre en milieu scolaire, sur la base du témoignage d’adultes gais, lesbiennes, bisexuels, trans et non-binaires (LGBT+). Lors de chaque intervention, réalisée à la demande des établissements scolaires, les élèves de la classe sont invités à compléter un court questionnaire d’enquête. Ce questionnaire comprend une série d’énoncés présentant des situations lors desquelles les élèves rencontrés pourraient être amenés à côtoyer des personnes LGBT+ (par exemple : « J’apprends que ma meilleure amie est lesbienne »). Pour chacun de ces énoncés, les élèves peuvent identifier leur niveau d’aise face à la situation, en choisissant si elle les met très mal à l’aise, mal à l’aise, à l’aise ou très à l’aise.
Des malaises préoccupants
Ces données qui sont récoltées auprès des élèves de l’école secondaire font l’objet d’analyses, qui permettent au GRIS-Montréal d’identifier des tendances en matière d’ouverture à la diversité sexuelle et de genre. À titre d’exemple, un rapport publié par l’organisme en 2017 montre à quel point ses deux décennies d’intervention en classe ont vu la diminution significative des niveaux de malaise des jeunes par rapport à un grand nombre des mises en situation proposées.
Le GRIS-Montréal a analysé 35 705 questionnaires complétés par des élèves du secondaire à travers la province, entre les années scolaires 2017-2018 et 2023-2024. Les résultats, très préoccupants, montrent une hausse significative depuis 2017 des niveaux de malaise rapportés par les jeunes face aux personnes LGBT+. Par exemple, la proportion d’élèves se disant mal à l’aise avec l’énoncé « Deux femmes en couple ont le droit de fonder une famille et d’élever des enfants » a triplé dans les dernières années, passant de 7,2% en 2017 à 20,9% en 2023.
Comment expliquer ce revirement de situation?
Plusieurs facteurs sont en jeu, parmi lesquels une conversation sociale tendue autour des sujets LGBT+, et particulièrement de l’identité de genre, depuis quelques années. Qu’il s’agisse de l’heure du conte avec des drag queens ou des toilettes scolaires non genrées, on présente les personnes LGBT+ comme constituant une menace aux enfants ou aux droits des femmes. Ensuite, la crise actuelle du journalisme met en péril la circulation d’informations vérifiables et accentue la désinformation. La structure des réseaux sociaux encourage la création de chambres d’écho, qui exposent presque systématiquement les internautes à des discours et opinions similaires aux leurs. Finalement, la montée du discours masculiniste et conservateur chez les jeunes, et particulièrement chez les garçons, crée un contexte de méfiance face aux personnes LGBT+.
À la lumière de ces résultats, et en cohérence avec la mission de l’école québécoise (« instruire, socialiser, qualifier »), il nous semble important de continuer d’inclure les réalités LGBT+ aux contenus scolaires, et notamment en éducation à la sexualité. Les organismes travaillant à mettre en évidence des représentations variées et positives de personnes LGBT+ gagnent à continuer leurs actions en milieu scolaire. Il en va de la qualité du climat de scolarité de tous les élèves du Québec. Bon nombre d’élèves sont concerné·es par les réalités LGBT+, que ce soit directement ou par le biais de leur famille ou de leurs ami·es proches. Ces élèves ont aussi le droit de se sentir en sécurité et sentir qu’ils comptent dans leur milieu d’apprentissage.